| |
Expliquer les processus vitaux fondamentaux en recourant
à la modélisation mathématique
: personne ne s'était engagé dans cette
voie avant le professeur Gilbert Chauvet. Entretien
avec le fondateur d'une discipline scientifique au
vertigineux potentiel.
C'est ce qu'on appelle un cas.
L'étonnant parcours en effet, que celui
de Giilbert Chauvet ! Agé aujourd'hui de 59
ans, il a passé son enfance en Vendée
dans une famille des plus modestes (le père
était cheminot, la mère sans emploi)
mais qui l'a poussé à faire des études.
Gilbert Chauvet a manifesté très tôt
de belles dispositions. "Tout m'intéressait,
j'étais d'une curiosité insatiable",
souligne-t-il. Ce phénix (il a décroché
son bac avec la meilleure moyenne du département)
rêvait d'une carrière de médecin.
"Mais dans mon milieu, ça semblait inaccessible.
On m'imaginait plutôt en instituteur. Alors
je suis rentré sans enthousiasme, à
l'Ecole normale d'instituteurs." Au directeur
de l'établissement qui allait bientôt
s'étonner de ses notes désastreuses
en pédagogie, le jeune homme confia qu'il aspirait
à l'université. La chance lui fit signe
deux mois plus tard sous l'espèce d'un décret
offrant une passerelle universitaire aux meilleurs
élèves de ces écoles. La carrière
de Gilbert Chauvet était lancée mais
aller s'avérer atypique. Songez qu'après
un DEA de mathématiques, il bifurqua vers la
physique théorique (thèse de troisième
cycle en physique du solide, et doctorat d'Etat en
physique moléculaire) puis fit médecine
avant d'opter pour la biologie !
... Mais la biologie théorique :
"C'est qu'une chose m'agaçait depuis longtemps
: je comprenais mal que la biologie ne soit que descriptive
et pas explicative au sens de la physique. J'ai voulu
corriger cela." Sa maîtrise des maths
et ses connaissances en physique allaient lui donner
les outils de son projet : recenser, corréler,
intégrer et modéliser les phénomènes
physiologiques, depuis la molécule jusqu'à
l'organisme en passant par les différents niveaux
intermédiaires de la cellule, du tissu et de
l'organe. Une folle entreprise. "Il m'a fallu
quinze longues années d'efforts acharnés
et solitaires pour parvenir à mes fins."
Le résultat, publié chez Masson en 1991,
couvre 1500 pages avec profusion de symboles, formules,
équations, graphiques, tableaux et schémas.
Fait révélateur de l'intérêt
de ce travail : traduit immédiatement en anglais,
l'ouvrage a été édité
et diffusé au Etats-Unis.
On a peine à imaginer qu'on puiss mettre
la vie en équations. Et pourtant... "En
physique, indique Gilbert Chauvet, un système
est d'autant plus instable qu'il est complexe. En
biologie, non. Même très compliqué,
un organisme apparaît étonnemment stable.
Pourquoi ? C'est ce que j'ai cherché à
comprendre par le biais des mathématiques.
Une chose m'avait frappé : le caractère
rigoureux, universel et puissamment explicatif des
mathématiques. Je suis un mécréant
pour qui Dieu, c'est l'intelligibilité mathématique
de la nature !" Jolie formule... "J'ai
d'abord bâti un cadre théorique, poursuit-il.
Ce qui supposait des concepts nouveaux. Pour ce faire,
j'ai extrait ce qu'il pouvait y avoir de commun dans
les fonctions physiologiques et à tous les
niveaux d'organisation du vivant, de façon
à dégager une théorie unificatrice.
Ma formation de physicien m'a évidemment beaucoup
servi. Que fait la physique ? Elle décrit l'état
de la matière à partir des force qui
la lient : la force gravitationnelle, la force nucléaire,
l'électromagnétisme, la thermodynamique,
etc. Toutes choses qu'on peut formuler en termes mathématiques.
Un système physiologique est aussi, bien sûr,
soumis à une combinatoire d'interactions selon
une certaine hiérarchie : on ne peut passer
de la structure 1 à la structure 3 sans passer
par la structure 2." Disons, pour résumer,
que Gilbert Chauvet a mis en évidence le caractère
mathématique de l'association des structures
biologiques, fondement de la stabilité du fonctionnement
de l'organisme vivant. Et donné ainsi une solide
base théorique à ce qu'il appelle la
physiologie intégrative.
Outre que cette nouvelle discipline ouvre un
champ immense à la connaissance du vivant (elle
peut aider, en particulier, à mieux comprendre
les mécanismes de l'évolution des espèces,
et le fonctionnement du cerveau), elle va permettre
la mise au point de techniques et instruments médicaux
d'investigation et de diagnostic, et faciliter l'élaboration
de nouveaux traitements thérapeutiques. Elle
autorisera, par ailleurs, une simulation de l'action
des médicaments.
Mais là, question. Attend-on que les
Etats-Unis s'emparent du cerveau de Gilbert Chauvet
(ils l'ont déjà sollicité) ?
L'exploitation de ses travaux ne réclame pourtant
pas d'énormes moyens : seulement de quoi payer
quelques ordinateurs et quelques informaticiens. Un
financement public, ou public-privé, relève-t-il
de la gageure ?
Ce serait à désespérer de la
France...
|
|
INVITÉ
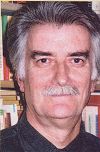
Mathématicien, physicien, médecin,
physiologiste et informaticien, Gilbert Chauvet
est professeur de biologie mathématique à
la Faculté de médecine d'Angers et
à l'Université de Californie du sud
(USC, Los Angeles).
Co-directeur du nouveau Centre de recherche en physiologie
intégrative (Hôpital Cochin, Paris),
il est également rédacteur en chef
de la revue internationale "Journal of Integrative
Neuroscience".
Bibliographie
Outre son "Traité de physiologie théorique"
(Masson), Gilbert Chauvet a écrit un ouvrage
de vulgarisation, "La vie dans la matière
; le rôle de l'espace en biologie" (Flammarion,
collection Champs), dont il donnera prochainement
un second volet, consacré celui-là
au "temps en biologie".
|
|

